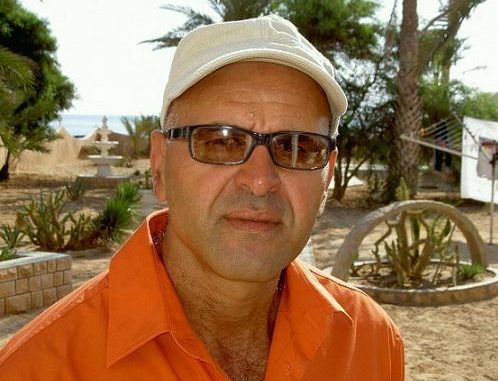
Le si fragile équilibre du monde
Entretien d’Olivier Barlet avec Mohamed Zran à propos de Vivre ici
On sent dans «Vivre ici» la poursuite d’une démarche documentaire débutée avec «Le Casseur de pierres» et présente dans vos fictions, «Essaïda» et «Le Prince». Avec «Le Chant du millénaire», vous retournez à la démarche documentaire propre, mais avec «Vivre ici», votre intention semble d’élever radicalement le propos.
En fait, je crois que c’est une suite de démarches qui se sont imposées à moi et que je pourrais résumer par mon rapport à l’espace. Essaïda est un quartier périphérique et Le Prince se déroule à Tunis, dans l’avenue principale ; Le Chant du millénaire voyage dans plusieurs pays, un voyage dans la vie des gens, et Vivre ici est aussi un déplacement, vers les origines, mais c’est un lieu, ma ville natale, bien que ce ne soit pas un film sur une ville. Je suis toujours interpellé par l’espace. Il me semble que l’espace doit être à l’origine de tout. C’est comme dans la vie, l’espace appelle la vie, appelle l’atmosphère et du coup l’intrigue, l’écriture. C’est quelque chose que je réalise maintenant et sur quoi je fais mes pas, comme un funambule, doucement, tout en essayant de garder l’équilibre et l’équilibre, en fait, c’est cette ligne-là. Comme un funambule, c’est essayer d’être à la fois dans la vie et dans le rêve, dans l’imaginaire et cette extraordinaire passion, cette envie de ne pas quitter le réel parce que le réel est une source extraordinaire, mais dont il faut se décoller pour se permettre de la poésie. Mon cinéma est celui d’un funambule qui essaye de mettre un pas dans le réel, un pas dans la fiction, et de trouver l’équilibre, de ne tomber ni totalement dans l’un, ni totalement dans l’autre. Parce que le réel a tellement besoin de la fiction, sachant que la fiction est toujours en avance par rapport au réel ! La fiction a une grande vérité et on trouve ses repères dans cet imaginaire par rapport à notre culture, à sa mémoire : c’est comme ça que les gens peuvent être touchés, en trouvant la référence.
Il n’est pas neutre de retourner dans sa ville natale après tout cet itinéraire. Quel ancrage cherchiez-vous ?
- L’ancrage, c’est la ville, la banlieue, mes trois tableaux, en fonction de la maturité, de mes voyages, la contemplation de cette ville par la distance, des gens que je connais. J’ai eu envie d’en faire le miroir. J’ai commencé à voir des personnages. Mais comment faire des films aujourd’hui, dans ce monde hyper éclaté, dont évoluent si vite les mœurs et les cultures ? Et cela au sein de cette masse d’images et de films qui nous parviennent. Comment continuer à faire des films différemment ? Comment avancer, comment trouver un autre élan ou chercher à voir autrement, tout en étant chez soi, ici avec ses petits moyens, face à la fermeture des ressources et des guichets. C’est une réflexion à la fois artistique et liée à un constat sur l’état du cinéma en Tunisie, et sur ce que je vois ailleurs aussi. Comment créer et écrire autrement dans un monde qui subit la crise et beaucoup de contradictions ? Un film est un carrefour où il faut s’orienter vers une autre manière de voir le monde, de raconter les histoires. Le plus proche, c’était de revenir à Zarzis, cette ville que je connais tellement bien. Avec ces personnages extraordinaires qui ont nourri mon enfance, mon imaginaire. C’était d’aller au plus simple, juste à côté, mais prendre le temps de le voir, de le contempler et de l’écrire avec sérénité, avec distance et profondeur. Il fallait prendre le temps de voir, d’écrire, de filmer, de rêver. Les moyens numériques nous permettent de prendre le temps et laissent le temps d’écrire, comme avec un stylo, un pinceau. J’ai commencé à travailler comme un écrivain qui se réveille tous les jours en se disant : «tiens, la phrase commence par ça et puis hop elle finit comme ça». Quand j’étais prêt, je sortais avec la caméra.
Vous indiquez au générique une collaboration pour l’écriture avec Kamel Ben Ouanès. Comment avez-vous travaillé ensemble ?
- Kamel est un ami et quelqu’un qui est très sensible à mes idées. On se réunit quasiment à chaque tournage, et il m’aide à mettre les choses sur papier plus clairement.
En revenant dans un lieu d’enfance, une partie de l’approche est faite mais, en même temps, ça peut être un peu polluant : ne risque-t-on pas d’ être trop dans le souvenir, dans la nostalgie ?
- C’est marrant cette question car je n’y ai jamais pensé. Je n’ai pas voulu fonctionner par nostalgie, j’ai essayé de mettre la distance. J’ai plutôt vécu le tournage, comme l’écriture, au jour le jour. Chaque moment est différent, mais aussi surprenant, générateur de quelque chose d’inattendu. Au cinéaste de capter ça. Dans cette démarche, tout est imprévu, rien n’est fixe, tout est en mouvement. Comment le capter ? C’est ça qui est excitant !
Le fait que Zarzis est votre ville natale n’est pas mentionné dans le film. Pourtant, Simon l’épicier juif, autour de qui tout le filme tourne, a dû être un personnage important de votre enfance. En même temps, il représente une diversité tunisienne aujourd’hui problématique…
- Oui, il y a eu un exode de juifs tunisiens après la guerre, mais pas à cause de la Tunisie. Moi, je condamne Israël, parce qu’il nous a pris nos frères. Il fallait peupler Israël et donc démunir les autres, nous privant de cette richesse ! Aujourd’hui, ils sont nombreux à revenir, qui s’installent et font des affaires.
Vous montrez aussi le rassemblement de Djerba.
- Oui, c’est le pèlerinage annuel de tous les juifs orientaux et ça, c’est un bon signe. Ils reviennent dans leur famille et ils sont déchirés parce qu’avec le temps, ils s’aperçoivent de la qualité de la vie qu’ils avaient en Tunisie en comparaison du problème palestinien ; on sent leur amertume.
L’épicier Simon est toujours obligé de rappeler que sa famille est implantée là depuis des générations. On voit combien le rapport est faussé.
- Oui, à cause des médias, des chaînes satellites… En Tunisie, les juifs sont restés maîtres chez eux. Ils n’ont pas subi la haine, comme en Algérie ou en Lybie. La Tunisie est un cas particulier : les juifs ont toujours été des citoyens, même avant Bourguiba. C’est pour cela que Simon défend son appartenance tunisienne.
Et se révèle le plus patriote !
- Absolument !
Donc, pas de nostalgie d’enfance, mais en même temps une musique récurrente, douce, profonde, classique. Elle semble correspondre à des personnages en quête d’absolu, en une sorte d’élévation qui donne au film toute sa grandeur.
- Voilà qui est bien vu, c’est exactement ce que j’ai cherché. Dès la première semaine, la question de la musique s’est posée et très vite elle est devenue claire. En filmant le taxi, j’ai tout de suite su quelle musique il fallait : une musique où Mozart et Beethoven peuvent passer par là, c’est-à-dire une musique grandiose, d’élévation, que n’importe qui dans le monde peut entendre et ainsi se dire que Zarzis est n’importe où. Je ne filme pas pour reproduire le réel : la forme développée tend à élever, par le discours des personnages, par la position de la caméra, par le montage et par la musique. La musique doit respecter les personnages. Ces grands musiciens s’incarnent en Casimir ou Simon, avec une émotion universelle, une émotion incroyable où chacun de nous peut trouver une petite part dans sa tête et dans son cœur.
Ils ont une dimension humaine magnifique et le fait de les balader en taxi décapotable renforce leur dignité !
- Je voulais écrire ce film avec ces images, qui sont pour moi comme des phrases. Le taxi, c’est l’idée de cinéma, de rendre ces personnages objets de rêve. Sans doute ai-je pensé aux travellings de Godard. Je me suis dit qu’il fallait un peu de magnificence pour ces personnages extraordinaires.
L’artiste handicapé est très fort au niveau symbolique. Il essaye de communiquer avec les autres sur son propre mode et on voit Simon le regarder un peu dépité, mais il y a une écoute respective.
- Exactement, c’est ça qui est intéressant. Cet artiste incarne une partie de chacun de nous, une fragilité, un rêve… Il est un des derniers survivants de cette façon de voir et de rêver l’art car aujourd’hui, avec la mondialisation et le rapport à l’argent, l’efficacité, ces gens-là sont rares.
En plus, il s’est impliqué en France dans le théâtre avec des immigrés, une démarche engagée.
- Voilà ! Et cette démarche est rare, en voie de disparition. C’est pour cela que j’ai voulu lui rendre hommage. C’est comme un signal d’alerte pour moi : il faut léguer aux générations futures le fait que la création culturelle est quelque chose d’essentiel pour la croissance de l’esprit et de l’imaginaire. Et lui, c’est un des derniers vétérans. Simon ne le comprend pas, mais il le respecte et prend le temps de l’écouter. Ce partage est essentiel. Pour l’artiste, l’homme c’est l’homme, indépendamment du statut social ou du niveau intellectuel. Le respect de l’homme est fondamental. Voilà, je suis encore idéaliste, peut-être naïf !
Il y a un autre idéaliste dans le film, c’est l’instituteur qui est tellement dans la transmission, mais dont tous les enfants sont partis, c’est terrible !
- Oui, il en souffre énormément. Tahar a des références idéalistes, universalistes et humanistes qu’il cherche à transmettre aux générations futures. Aujourd’hui, il insiste sur le respect de l’environnement, de la différence : de couleurs, de cultures, d’idées. C’est un défenseur de la liberté, de la démocratie dans un monde qui est en faillite totale. Ce qu’il condamne, ce monde en dérive, le frappe de plein fouet avec le départ de ses enfants.
Sa femme, elle, est contente qu’ils soient allés chercher un autre destin, même si elle est triste qu’ils soient loin. Elle est persuadée qu’ils sont sur une voie de réussite puisqu’elle a tellement intégré le fait que la réussite c’est le départ !
- Elle, elle est dans l’imitation, elle est simple, mais elle est aussi dans la fatalité : « il n’y a pas de travail ici ! ». Elle est totalement dans la société, dans ce qui se passe, et elle le subit tranquillement, « c’est comme ça », alors que lui il est dans la résistance. Mais les choses sont plus fortes que lui : il n’a pas les ficelles pour trouver des solutions parce qu’il n’a pas de pouvoir dans cette société. Il reste un de ces derniers survivants, de ces rêveurs humanistes, à qui je rends hommage.
N’est-ce pas terrible de se dire que ce sont les derniers rêveurs ?
- Oui, c’est terrible, mais c’est vrai. C’est ça ce film ! C’est un signal d’alerte, pour respecter ces gens-là, pour se repositionner, pour voir où va le monde.
Je trouve la rencontre avec des touristes sourds-muets sur une plage déserte absolument incroyable. Elle donne une dimension presque cosmique au récit !
- Je pense que ce sera une scène mythique du cinéma, en toute modestie ! Nous parlions de l’écriture des films. Je cherche à travailler différemment. Constater le désert, le départ des touristes, et puis arriver avec cette scène à un degré supérieur. Cela m’est arrivé comme un cadeau. C’était extraordinaire, l’imprévu. J’étais là, et paf ! C’est un des plus beaux moments de ma vie. Ils parlent et chacun commence à écrire sur le sable son histoire ! Et ils découvrent qu’ils partagent un drame très humain, et lui ne s’acharne pas pour leur vendre ses babioles et réalise la chance qu’il a de pouvoir parler ! Ce rapport au langage évoque la compréhension qui dépasse la langue, malgré l’opposition des cultures et des richesses.
Le dernier couple du film, un Tunisien et une Berlinoise, incarne cette opposition culturelle et le film débouche sur un moment de grâce. Ils cherchent l’équilibre comme le monde le cherche.
- C’est absolument ça. Je voulais marquer la situation dans laquelle est le monde et où il évolue. Les rapports Nord/Sud et hommes/femmes fonctionnent par opposition… Jutta vient en Tunisie chercher le rêve, mais elle est vidée, elle est déjà presque un cadavre. Fatalement, c’est dans cette partie du monde qu’elle sera objet de désir, en lien avec la situation tant politique qu’économique. Ces deux mondes se rapprochent par nécessité, parce que l’un a besoin de l’autre, et vice-versa. C’est une nécessité tragique, terrible, car chacun fuit son monde pour un autre qu’il imagine meilleur. On débouche sur notre temps qui cherche un équilibre, un équilibre si fragile !
Propos recueillis aux Rencontres cinéma de Manosque, février 2010
Source : http://www.africultures.com/

Poster un Commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.